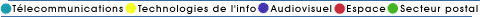
débat n°4 - 2 octobre 1998
Etoiles & Toile :
les constellations de satellites
multimédia
Compte-rendu1
rédigé par Sébastien HEINTZ et Stéphane LEROY
(Ecole Nationale Supérieure des Postes et
Télécommunications),
sous la supervision de Patrick
OLIVIER et Godefroy
BEAUVALLET (DPT).
Les systèmes de télécommunications par satellites
non géostationnaires, qui apparaissaient comme des projets irréalistes il y
encore moins de dix ans, sont sur le point de trouver une concrétisation avec la
mise en service du système Iridium
de Motorola, en novembre1998, et de son
concurrent Globalstar, dirigé par
l’américain Loral et le français Alcatel, au troisième trimestre 1999.
Cependant, aujourd’hui, si les défis technologiques ont été relevés et la
barrière financière de l’investissement initial franchie, il reste, d’une part,
à obtenir dans certains des pays où le service sera offert les autorisations
nécessaires à l’exploitation commerciale et, d’autre part, à trouver des
débouchés commerciaux à la hauteur des attentes des investisseurs parti prenante
à l’aventure.
Dans ce contexte, ces quatrièmes débats
IDEE Télécom s’articulent autour de trois axes :
- brosser un tableau d’ensemble de la situation actuelle et à venir des
télécommunications par satellites ;
- évoquer les cadres réglementaires international et européen dans lesquels
ces nouveaux opérateurs vont développer leurs activités ;
- examiner un cas concret, celui du système satellitaire de
télécommunications fixes multimédia SkyBridge.
1. Situation actuelle des télécommunications par
satellite
François RANCY, Directeur de la Planification du spectre et
des affaires internationales, Agence Nationale des Fréquences
1.1 Services offerts et historique des systèmes de communication par
satellites
Il existe, en théorie, deux grandes catégories de services de
communication spatiale, qui conditionnent les bandes de fréquences radio
employées par les différents systèmes de communication par satellites :
- en premier lieu, on trouve les services de télécommunications, d’une part
mobiles, qui utilisent essentiellement les bandes de fréquences situées en
dessous des 3 GHz, et d’autre part fixes, qui utilisent essentiellement les
bandes de fréquences situées entre 3,4 et 30 GHz ;
- en second lieu, on trouve les services de radiodiffusion, autour de 1,5
GHz pour les services sonores et principalement autour de 12 GHz pour ceux de
télévision.
En pratique, les évolutions commerciales conduisent
progressivement, depuis quelques années, à une convergence entre les
domaines des télécommunications et de la radiodiffusion. Ainsi, depuis au moins
quinze ans, des satellites fournissent en Europe des services de radiodiffusion
dans des bandes de fréquences attribuées au service fixe par satellite ; on
observe également une convergence entre services fixes et mobiles. Par exemple,
le service Euteltracs
regroupe service mobile de messagerie et service de radiorepérage par satellite
en utilisant les bandes du service fixe par satellite.
Cette évolution s’inscrit dans l’histoire déjà relativement ancienne des
communications spatiales. Les premiers satellites
de communication ont en effet été lancés à partir de 1957 (Spoutnik). Ces derniers,
dont , n’étaient d’ailleurs pas géostationnaires,
les altitudes initialement accessibles aux lanceurs ne le permettant pas.
Cependant, du fait de leur plus grande facilité d’utilisation, les systèmes
géostationnaires, qui restent en permanence à la verticale d’un point de
l’équateur terrestre à une altitude de quelques 35.800 kilomètres, ont été
jusqu’à nos jours le vecteur principal du développement des télécommunications
par satellite.
Cependant, depuis quelques années, les technologies disponibles permettent la
fourniture de services de télécommunications destinés au grand public pour des
coûts raisonnables sur des satellites non géostationnaires. Ceux-ci présentent
en effet plusieurs avantages spécifiques, du moment qu’il est possible de
communiquer avec eux malgré leur mouvement par rapport à la Terre :
- en premier lieu, parce qu’ils sont plus proches de la Terre (c’est ce que
reflète leur appellation anglaise de systèmes
LEO, pour Low Earth Orbit), les systèmes utilisant des satellites
non géostationnaires autorisent des temps de propagation du signal radio
relativement faibles (environ 30 à 50 ms pour effectuer un bond
Terre-satellite-Terre) en comparaison de ceux des systèmes utilisant des
satellites géostationnaires (environ 300 ms par bond), ce qui est comparable
au délai offert par les systèmes de Terre. Cela positionne avantageusement les
systèmes non-géostationnaires pour acheminer les communications d’applications
fortement interactives et/ou à contrainte de temps réel ;
- par ailleurs, la couverture offerte par un système utilisant des
satellites non géostationnaires est par nature mondiale, grâce au défilement
des satellites non géostationnaires. Cependant, pour cette même raison, un
grand nombre de satellites est nécessaire pour assurer une couverture continue
en chaque point de la surface terrestre et donc pour permettre les
communications permanentes.
1.2. Les projets de systèmes satellitaires en orbite terrestre basse
(LEO)
Plusieurs projets LEO sont en cours de réalisation ou sur le point
de se concrétiser. On peut distinguer trois types de systèmes :
- les "petits
LEO", satellites de faible poids et faible débit, permettent de
fournir un service de messagerie. La constellation Orbcomm est ainsi déjà déployée depuis
quelques semaines ;
- les "gros
LEO", qui sont d’un poids plus important, permettent de fournir un
service de communications mobiles personnelles par satellite, complété par des
services de messagerie et de transfert de données bas débit. Les systèmes les
plus connus sont ici Iridium, dont
l’ouverture du service est prévue en novembre 1998, et Globalstar, qui doit entamer les
opérations commerciales à la mi-1999.
- les "méga
LEO", enfin, devraient permettre à partir de fin 2001 de fournir des
services fixes multimédia interactifs à haut débit. Les sociétés SkyBridge et Teledesic, si elles n’ont pas encore
lancé de satellites, sont lancer le développement des systèmes nécessaires.
On souligne souvent l’importance des coûts et des risques associés à
ces projets de constellations de satellites non géostationnaires. En effet, une
constellation de satellites de type "gros LEO" demande un investissement de un à
trois milliards de dollars ; les constellations de type "méga LEO" annoncent
pour leur part des montants investissements 3 à 10 fois supérieurs, compris
entre 4 et 15 milliards de dollars.
A titre de comparaison, un système de 3 satellites géostationnaires permet
une couverture mondiale s’étendant jusqu’à 60 à 70° de latitude (chaque
satellite assurant un tiers de la couverture globale) et nécessite un
investissement d’environ 600 millions de dollars.
Par ailleurs, les ressources fréquentielles nécessaires au développement de
ces systèmes sont de plus en plus considérables et doivent être rendues
disponibles au niveau international. Entre les systèmes de téléphonie (gros LEO)
et ceux de communication multimédia (méga LEO), les besoins en fréquences sont
ainsi multipliés par cent.
Les enjeux et défis technologiques sont également très importants. La mise au
point d’une constellation nécessite en effet la maîtrise d’une production de
masse des satellites (par dizaines), ainsi que des lancements groupés pour
éviter de consommer l’intégralité des capacités de lancement disponibles et
contenir les coûts. Enfin, la gestion de la constellation nécessite la mise en
place d'un réseau mondial de stations de contrôle.
1.3 Les acteurs du marché des communications spatiales
Le marché
le plus important aujourd’hui est celui des services fournis par les systèmes à
base de satellites géostationnaires, qui se scinde entre service mobile et
service fixe.
Dans le secteur de la téléphonie mobile par satellite, l’organisation
intergouvernementale Inmarsat,
initialement spécialisée dans les communications maritimes, y compris des
services de détresse et de sécurité, a progressivement étendu son champ
d’activité à d’autres services de téléphonie mobile où elle exerce une situation
de quasi monopole. Pour faire face à la concurrence croissante des systèmes de
Terre et à celle, naissante, des constellations de "gros LEO", avec pour
objectif de permettre à Inmarsat de
continuer à assumer sa mission première de communications en mer, les Etats
membres de l’organisation ont récemment voté la transformation d’Inmarsat en une société commerciale privée,
quelques années après la création de la société ICO, qui vise à offrir des services de téléphonie
mobile portable par l’intermédiaire d’une constellation de 12 satellites en
orbite intermédiaire (MEO).
Pour les autres type de service (fixe par satellite et radiodiffusion), le
marché des systèmes géostationnaires est actuellement dominé en Europe par SES-Astra et Eutelsat, qui exploitent chacun une
dizaine de satellites. Il existe par ailleurs des acteurs plus modestes tels que
Hispasat, Sirius ou Bifrost. Au niveau mondial, les
acteurs les plus importants sont Intelsat, PanAmsat, GE Americom et Asiasat, qui exploitent chacun une
vingtaine de satellites.
Cette situation est en cours d’évolution vers plus de concurrence du fait de
l’arrivée prochaine (1998 à 2000) des exploitants de constellations de "gros
LEO". Trois projets principaux s’affrontent aujourd’hui : ICO, exploitant européen dont Inmarsat détient 10 %, Iridium, projet américain initié par Motorola, et Globalstar, projet emmené par l’américain
Loral et auquel se sont ralliés Alcatel et France Télécom.
A plus long terme (2001-2002), deux grands projets s’affrontent sur le marché
des communications de données à haut débit. L’américain Teledesic, conduit par Bill
Gates et Craig McCaw,
vient en effet de s'associer
au projet Celestri
développé par Motorola et au projet West
de Matra
Marconi Space, fait face au projet SkyBridge, conduit par Alcatel.
1.4. L’accès aux ressources en fréquences radio
L'attribution de
bandes de fréquences radio-électriques aux systèmes satellitaires se décide à
trois niveaux :
- au niveau mondial, l'Union Internationale des
Télécommunications (UIT, basée à Genève) attribue, par région du globe, des
fréquences à des services de radiocommunications, en distinguant entre "Service
Fixe par Satellite", "Service Mobile par Satellite" et "Service de
Radiodiffusion par Satellite");
- au niveau européen, la Conférence Européenne des Postes
et Télécommunications (CEPT), qui regroupe 43 pays de la zone européenne,
peut prendre des décisions visant à harmoniser l’utilisation de telle ou telle
bande de fréquences en Europe (c’est le cas pour les fréquences des systèmes de
téléphonie mobile GSM, de radiomessagerie
Ermes, TFTS). Ces décisions peuvent être relayées par une directive
au niveau de l’Union européenne (UMTS)
;
- au niveau national, en France, c'est l'Agence Nationale des Fréquences
(ANFR) qui coordonne l'usage des fréquences par les administrations ou les
autorités "affectataires".
Au niveau mondial, l'UIT établit un Réglement des
Radiocommunications (le "RR"), lors des Conférences Mondiales des
Radiocommunications (les " CMR"), qui ont lieu environ tous les deux ans
(la dernière s’est tenue en 1997). Les modifications à ce
règlement sont préparées entre les CMR par le "secteur radiocommunications" de
l'UIT (l’"UIT-R") à travers des commissions d'études, un
comité spécial sur les questions
réglementaires et de procédure et des réunions préparatoires à la
Conférence. Le RR est constitué d’articles, qui définissent les procédures
d'accès et d'usage des fréquences, d’appendices, et de résolutions qui précisent
et complètent ces articles. Dans sa forme révisée lors de la CMR-97, ce réglement comporte
notamment les articles principaux suivants :
- article S5 et notes associées portant sur les attributions de
fréquences aux différents services ;
- articles S21 et S22 portant sur les contraintes techniques ;
- articles S7 à S14 portant sur les procédures.
Le
Règlement des Radiocommunications (RR) s'appuie sur les
principes suivants :
- les fréquences sont attribuées à des services, de façon à permettre
à chaque pays d'utiliser le spectre pour ses propres besoins sans causer de
brouillage préjudiciable aux autres pays. Les services acceptés au niveau de
l’UIT peuvent être incompatibles entre eux et
n'ont pas à être mis en œuvre simultanément sur un même territoire. Par
ailleurs, les attributions de fréquences sont différentes selon les trois
régions de l'UIT (Amérique, Europe/ex-URSS et
Asie/Pacifique) ;
- la cohabitation des différents systèmes est assurée par le respect des
dispositions réglementaires (procédures, contraintes techniques, etc.)
énoncées dans le Règlement ;
- le Règlement des Radiocommunications définit les relations entre "administrations"
(pays ou organisation intergouvernementale de satellites) en matière d’accès
au spectre et du partage de l’espace extra-atmosphérique. Chaque exploitant
privé de système à satellites est donc représenté par une administration à
l’UIT ;
- aucune station d’émission ne peut être établie sans une licence, délivrée
sous une forme appropriée et en conformité avec les dispositions du Règlement
des Radiocommunications par le gouvernement dont relève cette station (ancien
article 24, devenant article S18 à partir du 1er janvier 1999).
Pour remplir son rôle d’attribution des fréquences aux services et
définir les conditions d’accès par pays, l’UIT
appuie son action sur le principe de l’accès équitable aux ressources
radioélectriques pour tous les pays et sur celui de l’utilisation efficace du
spectre. La difficulté principale en matière de systèmes satellitaires est celle
du partage des fréquences, qui fait l’objet de décisions réglementaires
spécifiques à l’UIT. L’UIT peut en effet décider une coordination plus ou
moins poussée entre services opérant dans les mêmes bandes, en fonction des
possibilités techniques et des risques de brouillage d’un service par un autre.
Trois cas peuvent se présenter :
- lorsqu’il y a possibilité de coexistence dans une bande entre les services
qui bénéficient d'une attribution de fréquences dans cette bande et que cette
coexistence peut être assurée par le respect de certaines contraintes
techniques précises (de puissance d’émission par exemple), aucune coordination n'est
requise ;
- lorsqu’il existe des risques de brouillage qui pourraient détériorer la
performance des systèmes cohabitant dans une bande de fréquences, il est
possible de mettre en œuvre des procédures de coordination selon
le principe du "premier arrivé – premier servi". Ce sont également ces
procédures qui s’appliquent pour la coordination entre
systèmes utilisant des satellites géostationnaires, ainsi qu’entre stations
terriennes et stations de Terre. Cette approche simple peut cependant se
révéler inadaptée en cas de partage difficile. Elle comporte en outre le
risque de favoriser un accès inéquitable aux fréquences et l’apparition de
"réseaux papiers" (réseaux fictifs destinés à occuper administrativement les
fréquences et à limiter la concurrence) ;
- enfin, il est également possible de mettre en place des "plans de
fréquences" attribuant une capacité minimale à chaque pays selon le principe
"équitable = égal". Pour éviter à ces plans de rester figés dans leur
configuration initiale, des procédures de modification ont été prévues. Ces
procédures consistent à n'n’autoriser une modification que si elle est
acceptée par les administrations à qui elle pourrait occasionner des
brouillages. Ces procédures ne fonctionnent donc que si les critères de
protection associés sont appropriés et si le taux de remplissage effectif du
Plan est faible. Il faut reconnaître que cela n’est pas souvent le cas et que
de ce fait, les possibilités de modification sont en général limitées.
Selon ce dispositif, qui fait la part belle au principe du "premier
arrivé – premier servi", déposer un dossier de demande d’assignation de
fréquences a un coût quasi nul et un bénéfice maximal puisque ce dépôt permet à
la fois de "réserver" des fréquences pour des projets encore à l’étude (voire
théoriques), mais également de ralentir les concurrents qui déposeraient leurs
demandes ultérieurement, notamment en multipliant les difficultés liées aux
procédures de coordination. Le système connaît donc des limites. Pour
pallier ces difficultés, deux procédures ont été mises en œuvre :
- en premier lieu, le Conseil de l’UIT de
1997 a décidé que les coûts administratifs de fonctionnement de l'UIT pour accomplir les procédures de
coordination entre systèmes seront facturés ; cependant, la mise en œuvre de
cette décision est pour le moment freinée par l'action de certains pays,
notamment les Etats-Unis, qui sont de très loin les principaux consommateurs
(et donc les principaux bénéficiaires) de ce système ;
- en second lieu, la CMR-97 a permis d'adopter le
principe de la "diligence due administrative". Les opérateurs ont ainsi
l'obligation de fournir les renseignements sur leur projet de réseau, qui
seront publiés. Cela devrait contribuer à limiter les tentations d’abuser des
dépôts tactiques de dossier de demandes d’assignations.
Au-delà de ces
premières mesures, le principe de la diligence due financière est à
l'étude : s’il est adopté, les opérateurs devront verser une forme de caution
pour déposer une demande de fréquences, qui ne serait rendue que dans
l’hypothèse où ils réalisent effectivement et dans les temps le projet annoncé.
Au niveau européen, l’harmonisation et la coordination de l’usage des
fréquences, de même que la préparation des CMR, s'effectue dans le cadre de la
Conférence Européenne des
Postes et Télécommunications (CEPT), qui rassemble 43 pays européens. La
CEPT s'appuie pour ce faire sur l'European
Telecommunications Standards Institute (ETSI) en tant qu’organisme européen
reconnu de normalisation. Ces travaux sont également ouverts aux opérateurs,
regroupés notamment au sein de l'European Public
Telecommunication Network Operators Association (ETNO) qui regroupe en
association les opérateurs historiques, et aux industriels. La Commission
Européenne est également associée étroitement à ces activités.
En France, c'est l'Agence Nationale des Fréquences qui coordonne
l'attribution des fréquences à des administrations ou à des autorités dites
"affectataires" pour des services, tout en respectant le cadre général fixé par
l’UIT, la CEPT et l’ETSI. Les administrations "affectataires" font
des fréquences un usage propre, comme les ministères de la Défense, celui de l’Intérieur, l’Aviation Civile ou le CNES ; en revanche, les autorités "affectataires"
attribuent ensuite ces fréquences à des utilisateurs privés, comme les
opérateurs de télécommunications (par l’Autorité de régulation des
télécommunications) ou les opérateurs audiovisuels (par le Conseil supérieur de l’audiovisuel).
Du fait de la nature fortement internationale des attributions de fréquences
pour les opérateurs de constellations de satellites, il est nécessaire
d’approfondir le mécanisme de préparation des Conférences Mondiales des
Radiocommunications, au cours desquelles se décident ces attributions.
Les CMR sont tout d'abord préparées au niveau national. En France, des
commissions et des groupes de travail sont coordonnés au sein de l'ANFR afin de
présenter des propositions sur la base d'un consensus national entre
administrations, opérateurs et industriels.
Les 43 pays européens représentés à la CEPT examinent ensuite leurs
propositions respectives au sein du Groupe de Préparation des Conférences (CPG),
appuyé notamment par des groupes et équipes projet du Comité européen des
Radiocommunications (ERC). L'objectif est là encore d'arriver à un
consensus, ce qui permet d'établir solidement des propositions européennes
communes aux CMR, où le mode de prise de décision est celui du consensus.
Si ce mode de préparation s'est montré particulièrement efficace lors des
dernières CMR depuis 1992 en engageant toute l’Europe dans des propositions
communes solides, il importe cependant de souligner que la concertation
européenne préparatoire aux CMR est favorisée par la faible distance
géographique entre capitales en Europe, ainsi que par la proximité des instances
de l’UIT (Genève). Dans d’autres régions du
monde, la concertation et la préparation sont donc souvent plus difficiles et
moins complètes.
2. Les nouveaux systèmes de constellations de
satellites
Frédéric PUJOL , IDATE
L’exposé de
Frédéric Pujol se scinde en trois points :
- les projets actuels de constellations de satellites LEO (Low earth
orbit) ;
- la complémentarité/concurrence avec les systèmes de Terre ;
- les constellations de deuxième génération (méga LEO).
2.1. Les projets actuels de constellations de satellites LEO
Même
si les projets actuellement en voie de réalisation sont variés, il est possible
de donner une définition générale de ce type d’investissements. Il s'agit de
systèmes ayant recours à une nouvelle génération de satellites de
télécommunications, comportant des innovations technologiques comme les
communications intersatellites ou le multi-channelling,
placés en orbite terrestre non géostationnaires et proposant des services
novateurs à l’échelle mondiale sur de nouveaux marchés de niche plutôt que grand
public. Ces projets sont le fait de nouveaux acteurs qui mettent en œuvre des
stratégies en rupture avec les projets satellitaires précédents. Ainsi, Motorola, industriel non opérateur, est néanmoins
très impliqué dans les projets LEO. Il importe de souligner la vitesse de
l’évolution des mentalités sur ces systèmes : considérés comme irréalistes
jusqu’en 1992, ils sont aujourd’hui en voie de banalisation.
Ces nouveaux systèmes satellitaires ont également entraîné la nécessité de
nouvelles décisions réglementaires et industrielles : attribution de licences et
de bandes de fréquences, fabrication et lancement de satellites en masse, etc.
On peut distinguer trois catégories de constellations de satellites de type
LEO, qui correspondent notamment au échelles de poids de satellites :
Petits Leo
40 à 100
kg |
Ces projets représentent des
enjeux relativement modestes en termes de services, puisqu’ils sont
limités à la transmission de données bas débit, principalement aux
applications de radiomessagerie asynchrone ; ils ont déjà une réalité
concrète (en particulier avec Orbcomm). |
Gros LEO
450 à 700
kg |
Ces projets doivent permettre de
fournir un service téléphonique au public ainsi que de transmission de
données bas débit. Le projet "gros LEO" précurseur fut Odyssey,
lancé par TRW au début des années 1990.
Faute de financement suffisant, il a été abandonné à la fin de 1997 ; TRW a alors rejoint le projet ICO d'Inmarsat. Les projets actuellement en
cours ou sur le point d'être opérationnels sont ceux d'Iridium (ouverture possible du service
en novembre 1998), de Globalstar
(mi 1999) et ICO. |
Méga LEO
500 à 1000
kg |
Ces projets proposeront des
services de télécommunications multimedia fixes à haut débit par
constellation de satellites. Il s'agit principalement des systèmes Teledesic et SkyBridge. Leur
positionnement vient en complémentarité et/ou en concurrence des systèmes
terrestres (LMDS,
MMDS,
UMTS-WLL,
ADSL, CATV, réseaux locaux en fibre
optique) ou géostationnaires (WEST). |
2.1.1. Caractéristiques techniques des constellations de satellites
LEO
Ces projets reposent, à l’inverse des satellites actuellement en
service, sur ces satellites non géostationnaires placés sur des orbites
relativement basses (de quelques centaines à quelques milliers de kilomètres).
Du fait de cette relative proximité entre le satellite et le terminal terrestre
ou la station passerelle, le signal nécessaire à établir la communication est de
moindre puissance que pour un système géostationnaire, d'où des terminaux plus
intégrés, c’est-à-dire moins gros. La proximité des satellites permet également
d’obtenir des délais de transmission particulièrement intéressants pour les
applications à contrainte de temps réel.
Le caractère défilant des satellites permet d'autre part d'assurer, moyennant
un nombre minimal de satellites, une couverture géographique globale .
A ces avantages spécifiques aux satellites LEO, il convient également
d'ajouter le fait que tout système satellitaire – géostationnaire ou non –
demande peu d'infrastructures en comparaison avec les systèmes de Terre :
quelques stations terriennes, sans commune mesure par exemple, dans le cas de la
téléphonie cellulaire de Terre, avec le déploiement nécessité par un réseau
cellulaire.
Au-delà de ces caractéristiques communes, les systèmes différent sur
plusieurs points, notamment sur les modes d'acheminement des communications.
Ainsi, dans les systèmes Iridium et Teledesic, il est prévu de mettre en place
des communications intersatellites (interlinks). Selon
ce mode d’opération technique, il est possible de choisir dans quel pays les
communications effectuées à partir du réseau spatial sont interconnectées aux
réseaux terrestres, et donc d’éviter les pays où les charges d’interconnexion
internationales (taxes de répartition) sont particulièrement élevées
(by-pass).
Ce contournement des réseaux nationaux pourrait par endroit entraîner une
perte sensible de revenus issus des appels internationaux, notamment dans les
pays en voie de développement. Ces revenus pouvant représenter une grande part
des revenus des opérateurs historiques, dans la mesure où le trafic
international amène une marge importante lorsqu’il n’y a pas concurrence, cela
n’est pas sans poser à ces opérateurs des problèmes stratégiques majeurs.
Cependant, cette perte de trafic devrait être limitée dans les pays où il
existe déjà des réseaux de communications mobiles terrestres (GSM ou équivalents) ; en effet, la plupart
des terminaux seront bi-standards (téléphonie mobile terrestre et satellite), ce
qui permet de conserver le trafic quand il existe un réseau terrestre – et de ne
payer le prix de la communication par satellite que lorsqu’elle est
véritablement nécessaire.
Par ailleurs, le by-pass peut être interdit par les autorisations
données aux opérateurs nationaux commercialisant les services Iridium, notamment pour des raisons de
sécurité (écoutes judiciaires, par exemple). Ceci souligne le rôle-clef des
distributeurs locaux des services des réseaux satellitaires ; seuls les acteurs
locaux disposent en effet de la connaissance suffisante de leur marché pour
mener à bien ce type de négociations avec les autorités nationales.
A contrario des projets Iridium
et Teledesic, les systèmes Globalstar et SkyBridge ne prévoient pas de
liens intersatellitaires ; les satellites sont donc de simples "tuyaux coudés"
(bent
pipes) qui transmettent les signaux entre le terminal de l’abonné et une
station relais, sans aucun élément de commutation en orbite.
Autre différence technique entre les différents projets, les modes d’accès
radio. Comme dans les radiocommunications numériques terrestre, deux approches
se côtoient en ce domaine : les systèmes à division temporelle (TDMA)
et ceux à division par code (CDMA).
Ces choix distincts ne sont pas sans conséquences sur la cohabitation entre
systèmes, afin d’éviter tout risque de brouillage - dans les bandes de
fréquences utilisées pour le service, bien entendu, mais également dans les
bandes de fréquences utilisées pour le contrôle des satellites.
Pour conclure sur ces éléments techniques des différents projets de
constellations, on peut dresser le tableau suivant :
| |
Iridium |
Globalstar |
ICO |
Odyssey
(abandonné) |
Teledesic |
Orbcomm |
| Satellites |
66+11 |
48+8 |
10+2 |
12 |
288 |
36 |
| Plans orbitaux |
6 |
8 |
2 |
3 |
|
4 |
| Stations
terrestres |
20 |
90 à 200 |
12 |
8 |
16 |
4 aux E-U |
| Services |
Voix-données |
Voix-données |
Voix-données |
Voix-données |
Multimédia |
Données |
| Interface radio |
TDMA |
CDMA |
TDMA |
CDMA |
TDMA |
TDMA |
| Fréquences
services |
L |
L |
S |
L et S |
Ka |
VHF |
| Fréquences
exploitation |
Ka |
C |
C |
Ka |
|
VHF |
Source : IDATE
2.1.2. Marchés, services et acteurs
Par construction, les
constellations de satellites offrent une couverture mondiale, quel que soit le
relief. Cependant, des limites apparaissent, notamment en milieu urbain dense :
- la couverture n'est pas assurée sans visibilité directe et la liaison
risque donc de ne pas être assurée à l'intérieur de bâtiments ("in
door") ;
- un nombre limité de conversations peut être acheminé simultanément à
partir de chaque cellule vers un satellite (spot).
C'est
pourquoi ces systèmes apparaissent nettement complémentaires de systèmes
cellulaires terrestres là où ils sont déployés, et notamment dans les zones
urbaines.
En revanche, les systèmes satellitaires non-géostationnaires permettent
d’offrir une connectivité instantanée à l’échelle mondiale à un coût inférieur à
celui des systèmes Intelsat ou Inmarsat là où les services mobiles
terrestres ne sont pas présents, notamment dans les zones rurales non rentables
(zones très enclavées, zones peu denses).
Dans ce contexte, le marché potentiel pour les services satellitaires est
difficile à évaluer ; le marché inital semble résider principalement dans des
niches spécifiques, la plus citée étant celle des voyageurs internationaux
(global roamers).
En matière de communication de données, une offre de transfert de données bas
débit est prévue par les constellations "gros LEO". Cependant, ces offres sont
sans commune mesure avec les débits que proposeront les constellations "méga
LEO", dont le cœur de cible est le service fixe haut débit pour le multimédia.
2.1.3. Coûts des constellations
Il importe avant de donner des chiffres sur le coût des constellations de
satellites de souligner que le service offert est par nature mondial, ce qui
rend trompeuses les comparaisons avec les systèmes terrestres, qui sont pour
leur part locaux :
- les constellations de type "petits LEO" sont des projets relativement
mesurés ; ainsi, le projet Orbcomm a par
exemple coûté 350 millions de dollars ;
- les constellations de type "gros LEO" représentent pour leur part un
investissement moyen 15 à 20 milliards de francs, ce qui représente
l’équivalent à la mise en place d’un réseau cellulaire terrestre en France.
De manière plus précise, l’IDATE a regroupé les annonces
des différents consortiums :
| Iridium |
3.4 milliards de
dollars |
| Globalstar |
2.5 milliards de
dollars |
| ICO |
3 milliards de
dollars |
| Odyssey
(abandonné au profit d'ICO) |
3.2 milliards de
dollars |
Les systèmes de type "mega LEO" sont eux beaucoup plus chers ; Teledesic annonce par exemple des
investissements de l’ordre de neuf milliards de dollars. Cependant, si ces
chiffres paraissent impressionnants, il faut garder à l’esprit qu’ils
fournissent une couverture mondiale ; à titre de comparaison, ils restent
comparables avec les prévisions de financement d’un réseau UMTS
couvrant la France (de l’ordre de 50 milliards de francs).
2.1.4. Jeux et stratégies d'acteurs
L’apparition des projets de
constellations de satellites non-géostationnaires a été l’occasion de
l’irruption de nouveaux venus dans le domaine des télécommunications spatiales,
ainsi que de nouvelles alliances, qui se sont progressivement affirmés comme des
acteurs de premier rang. En particulier, les industriels des télécommunications,
de la fabrication de satellites et de celle de lanceurs sont apparus très
moteurs dans l’initialisation et la conduite de ce type de projets.
Ces acteurs ont en particulier fourni les compétences techniques nécessaires
pour valider les concepts proposés et rassembler les financements nécessaires
aux investissements initiaux. En effet, les projets de constellations de
satellites étant de très grande envergure et comportant une part de risque
global très importante (comme l’a montré récemment l’accident
survenu le 9 septembre 1998 lors du lancement de 12 satellites de Globalstar – soit un sixième du nombre
total), à la fois en termes financiers, technologiques et économiques. Les
investisseurs ont donc été sceptiques au départ. Cependant, le marché boursier
s’est montré favorable une fois que ces projets ont reçu le soutien d'acteurs
solides du monde des satellites (Loral, Matra Marconi Space, etc.) et de
celui des télécommunications (Motorola, Alcatel, Microsoft, etc.).
Cependant, une fois les constellations opérationnelles, il devient nécessaire
d’y associer des distributeurs nationaux, qu’il s’agisse d’opérateurs de réseau
fixe, de radiocommunications ou de sociétés de commercialisation de services.
Les deux projets "gros LEO" rassemblent donc aujourd’hui chacun des industriels
porteurs de projets (télécommunications et spatial), des partenaires financiers
et des distributeurs nationaux de services.
La constitution d’alliances a également été indispensable en raison de
l’étude des compétences à mobiliser : terminaux, segment spatial, opérateur de
réseaux (système de facturation, de commercialisation, etc.). Selon ce
cheminement du projet, les industriels perdent tôt ou tard le contrôle des
activités, et par voie de conséquence celui de la valeur ajoutée. Mais
auparavant, ils auront réussi à démultiplier leur activité à moindre frais en
initiant de nouveaux services et de nouveaux réseaux.
2.1.5. Aspects réglementaires
Au niveau des pays, il peut être
nécessaire d'obtenir des autorisations à trois niveaux :
- pour l'exploitation du système spatial ;
- pour la mise en place et l’exploitation des stations terriennes ;
- pour les offres de services. Pour ce dernier cas, les consortiums doivent
obtenir des licences dans chacun des pays où ils veulent pouvoir
commercialiser leurs services.
Par ailleurs, les opérateurs de
services mobiles offerts par le biais des constellations de satellites doivent
pouvoir localiser leurs utilisateurs, notamment afin de pouvoir interdire
l’accès au service à partir du territoire d’un pays donné. Actuellement, cette
localisation semble être assurée à environ 10 ou 20 km près, selon les systèmes.
Enfin, certains pays imposent aux distributeurs de donner la priorité à un
réseau mobile terrestre à chaque fois que cela est possible ; les terminaux
bi-modes le permettent – il est cependant possible de passer outre cette
fonctionnalité (override). Les terminaux bi-modes devront indiquer à
l’utilisateur le passage d’un mode à l’autre, pour des raisons de coût
d'utilisation.
2.2. Complémentarité entre systèmes cellulaires terrestres et
constellations LEO
Les projets de "gros LEO" permettant d’offrir des
services de télécommunications mobiles utilisent des bandes de fréquences
proches de celles utilisées par les réseaux GSM et consorts ; les systèmes de contrôle
d’accès et les modes d’accès radio sont également similaires à ceux des réseaux
mobiles terrestres et il y a interfonctionnement avec les sous-système réseau GSM (protocole MAP) et américain (IS-41).
Ces similitudes permettent le développement de terminaux bi-modes compacts.
2.3. Le marché des constellations de satellites de télécommunications
fixes multimédias
Les satellites de type "mega LEO" visent le marché de
la transmission de données multimédias à haut débit et risquent d’être
confrontés à de nombreux concurrents opérant des plates-formes terrestres
à l’horizon 2001-2002. On peut notamment citer :
- le développement de l’xDSL
;
- l’amélioration des réseaux de diffusion (CATV HFC) ;
- la montée en puissance du LMDS
;
- la mise en place de l’UMTS
( à partir de 2002, jusqu’à 2 Mb/s).
Dans cette perspective, le
positionnement de ces futurs systèmes a d’ores et déjà du évoluer et se
rapproche de la fonction traditionnelle des satellites dans les communications
(part des télécommunications plus faible, utilisation massive en diffusion).
Cette volonté de positionnement complémentaire aux autres systèmes est également
présente par rapport aux satellites géostationnaires, particulièrement efficaces
pour la diffusion point-multipoint ; les "méga LEO" offriront en effet des
services point-à-point.
Cependant, de nombreux problèmes restent à résoudre avant que les systèmes SkyBridge ou Teledesic ne puissent ouvrir :
- les projets sont de très grand envergure financière ;
- les distributeurs de services ne sont pas encore déterminés ;
- les modèles économiques sont à valider ;
- des obstacles commerciaux et techniques ne sont pas franchis, notamment du
fait du manque d’expérience en commercialisation et du risque lié à la
diffusion non sécurisée des données.
3. Évolution du rôle de l'Union Européenne dans le domaine
spatial
Joël HAMELIN, Délégué à la Coordination Spatiale, Commission Européenne
3.1. L'Union Européenne et l'espace
La première communication de
la Commission Européenne sur ce sujet,
suivie d’une résolution du Conseil de
l’Union Européenne date de 1988. Bien qu’elle ait été précédée de prises de
position du Parlement Européen, elle
marque la prise de conscience de l'intérêt économique de domaine spatial,
notamment pour les télécommunications et pour l’observation de la Terre, et de
la forte compétence de l'Europe en la matière, démontrée notamment à travers ses
ambitieux programmes spatiaux, comme Ariane 5, Hermès et
la station Columbus décidés à la Haye par le conseil de l’Agence Spatiale Européenne un an plutôt.
Parallèlement, par l'Acte Unique,
la Communauté Européenne s’était vue conférer une compétence large en matière de
recherche et développement.
De ce constat et de cette compétence découlent les lignes d'actions qui ont
fondé l’action initiale de la Commission
dans le domaine spatial :
- promouvoir la complémentarité entre la recherche et développement
coopératif à l’échelon communautaire et les activités des agences spatiales
nationales ;
- développer une approche cohérente en matière de télécommunications
spatiales ;
- stimuler le marché des applications de l’observation de la Terre ;
- créer des conditions favorables à une adaptation des structures
industrielles à l’échelle européenne, conséquences du marché unique ;
- contribuer à l'établissement d'un environnement juridique et réglementaire
favorable au développement des activités économiques dans le domaine de
l’espace ;
- favoriser le développement de formations spécifiques (programme COMETT).
En 1992, il est apparu que la concurrence internationale s'était
accrue dans le domaine des télécommunications et des lanceurs spatiaux ; de
nouveaux acteurs étaient apparus, notamment la Chine et la Russie.
Parallèlement, le principe du financement public des activités spatiales a été
confronté à des restrictions budgétaires croissantes, ce qui a amené à remettre
en cause le projet d’avion spatial Hermès et la participation de l’Europe à la
Station Spatiale Internationale.
Les priorités ont alors été redéfinies.
Il s’agissait de :
- contribuer à l'établissement d'un système opérationnel européen
d’observation de la Terre ;
- garantir un cadre réglementaire favorable au développement des
télécommunications spatiales ;
- assurer la croissance et la compétitivité de l'industrie spatiale
européenne ;
- mettre en place une coopération internationale avec l'ex-URSS et les pays
d'Europe centrale et orientale.
De ces lignes d'actions renouvelées
découla la création du Groupe Consultatif sur l'Espace (Space Advisory Group ou
SAG), qui réunit les représentants des pays-membres, l'Agence Spatiale Européenne et la Commission, élargi parfois aux
organisations internationales de gestion de satellites Eutelsat et Eumetsat.
Un nouveau bilan a été effectué en 1996, alors qu'un large processus de
restructuration de l'industrie européenne se mettait en place. L'importance
stratégique de l'espace pour l'Europe dans l'avènement de la société de
l'information y a été soulignée, dans une communication, qui constate également
l’importance économique croissante des applications spatiales : télécommunications
personnelles, observation de la Terre, lanceurs et pour la première fois la
navigation par satellites.
Cette communication de 1996 est axée sur la promotion des applications, des
marchés et de la compétitivité de l'industrie en s'appuyant sur quatre lignes
d'actions :
- soutien de la compétitivité de l'industrie spatiale par des initiatives
réglementaires et normatives et par la mise en place d'instruments
d'ingénierie financière spécifiques ;
- mise en place d'une action coordonnée en matière d'observation de la Terre
;
- démarche auprès de l'Organisation Mondiale
du Commerce pour la libéralisation des services spatiaux de
télécommunications et action concertée pour l'allocation de fréquences et de
positions orbitales aux systèmes européens ;
- concertation et mise en cohérence des politiques de l'Agence Spatiale Européenne et de l'Union.
Ce point a été suivi d'effet avec la reconnaissance mutuelle des
légitimités respectives et complémentaires de l’Union Européenne et de l’Agence Spatiale Européenne, par la résolution commune adoptée
par le Conseil de l'Union le 22 juin 1998 et par le Conseil de l'Agence Spatiale Européenne en date du 23
juin 1998.
3.2. Les télécommunications spatiales
Les télécommunications spatiales
ont fait l'objet de l'attention de l'Union Européenne dès 1990 avec le Livre
Vert sur les communications par satellites. L'année suivante une résolution a
été adoptée sur ce sujet, suivie par plusieurs directives concernant les
équipements au sol (1993).
En 1994 la directive sur le
marché des télécommunications a été amendée pour y
inclure les communications par satellites. Une résolution est adoptée, la même
année, pour recommander une politique volontariste en matière d'accès aux
capacités spatiales.
Enfin, le plan d'action
sur les communications par satellite dans la société de l'information a été
adopté en mars 1997. C’est ce dernier que nous allons maintenant détailler.
3.3 Plan d'actions
Ce plan d'action vise à réaliser l'achèvement du
marché intérieur, à renforcer la position européenne au niveau international et
à soutenir la R&D européenne et le développement d'applications des
télécommunications par satellites. Chacun de ces axes fait l'objet d'une série
d'actions à mettre en œuvre.
L’achèvement du marché intérieur passe par :
- la mise en place effective de l'ensemble de la législation européenne ;
- le réexamen des barrières réglementaires existantes, en concertation avec
les industriels ;
- l’intensification des travaux de l'ETSI
dans le domaine de l'harmonisation ;
- l’orientation du programme de travail de l'ETSI selon les priorités du plan d'action (en
particulier pour la normalisation des terminaux de satellites multimédia).
Le renforcement de la position européenne au niveau international sera
favorisé par :
- la suppression des obstacles à l'accès au marché ;
- le réexamen des questions économiques et commerciales liées aux orbites et
aux fréquences ;
- le réexamen de la stratégie européenne dans les secteurs couverts par l'UIT ;
- l’évaluation des questions touchant aux droits de propriété intellectuelle
;
- l’évaluation des possibilités qu'offre une coopération politique et
industrielle accrue en union européenne et pays tiers.
Enfin, le
soutien à la R&D des acteurs européens du domaine se fait à travers le 5ème
Programme Cadre de Recherche & Développement (5e PCRD), qui contribue au financement
de la recherche coopérative et pré-normative. Le 5e PCRD a une enveloppe globale
de l’ordre de 15 milliards d'euros ; la partie télécommunications devrait en
représenter environ 25 % et le secteur spatial, au sein de la partie
télécommunications, entre 2 et 3%, soit environ 600 millions de francs.
Le cadre international d'activité des nouveaux
opérateurs
François RANCY, Directeur de la Planification du spectre et
des affaires internationales, Agence Nationale des Fréquences
4.1. Le spectre disponible pour des systèmes satellitaires
Les
bandes de fréquences suivantes ont été réservées pour les systèmes de
télécommunication fixe et de radiodiffusion par satellite :
- bandes de 10 à 18 GHz (Bandes Ku) : 2 x 2050 MHz ;
- bandes de 18 à 30 GHz : 2 x 2400 MHz ;
- bandes de 37 à 50 GHz : 2 x 5000 MHz.
Le rôle des régulateurs et
de l'UIT consiste à répartir équitablement ce
spectre entre tous les systèmes, géostationnaires ou non.
4.2. La CMR 1997
Un des principaux enjeux de la Conférence Mondiale des
Radiocommunications de 1997 était de rendre possible l'émergence d'une
concurrence effective dans la fourniture des services multimédia par satellites
à l'échelle mondiale. En effet, afin d'éviter les problèmes de brouillage entre
les systèmes géostationnaires et non géostationnaires quand les satellites
non-géostationnaires se trouvent momentanément dans la direction de l'orbite
géostationnaire, il avait été décidé lors de la Conférence de 1995 d'attribuer
une bande de 2 x 400 MHz au service fixe non géostationnaire. Compte-tenu des
procédures du Règlement des Radiocommunications et des besoins en fréquences de
ce type de systèmes, cela revenait à donner le monopole de la fourniture des
services au premier système non géostationnaire s’étant présenté, en
l'occurrence l’américain Teledesic.
Les décisions de 1997, qui complètent celles de 1995, permettent en revanche
d'organiser le spectre de manière à favoriser la concurrence :
- dans les bandes de fréquences de 10 à 18 GHz :
- 2 x 2050 MHz sont ouverts en partage entre systèmes géostationnaires et
non géostationnaires ;
- des limites "dures" de puissance à respecter ont été fixées afin
d’éviter tout risque de brouillage, ce qui permet d’éviter toute
coordination. Les valeurs de ces limites sont en cours d'examen par l'UIT-R
et devront être confirmées lors de la CMR de 2000. A ce jour, cet examen n’a
mis en évidence aucune difficulté particulière avec les limites actuelles
pour assurer la protection des systèmes géostationnaires ;
- les systèmes géostationnaires présents et planifiés sont protégés.
- dans les bandes de fréquences de 18 à 30 GHz :
- 2 x 1300 MHz en partage entre systèmes géostationnaires et non
géostationnaires, comportant également des limites " dures " de puissance
et, de ce fait, ne nécessitant pas de coordination ;
- 2 x 500 MHz en partage entre systèmes géostationnaires et non
géostationnaires sans limites de puissance, d’où la nécessité d’une
coordination et la mise en place de seuils de coordination (à l'étude) ;
- dans les bandes 18,1-18,4 GHz et 21,4-22 GHz, , aucune limite n’est
imposé mais l'article S22.2 s'applique - à savoir la priorité aux systèmes
géostationnaires.
- pour les bandes de fréquences supérieures à 30 GHz, aucune décision n’est
encore prise, mais le sujet est étudié à l’UIT.
Ces décisions ont donc permis de
rendre disponibles des quantités de spectre très importantes pour les systèmes
non-géostationnaires, sur une base équitable et partagée avec les systèmes
géostationnaires. Tous les problèmes ne sont pas pour autant résolus :
- pour le partage entre systèmes géostationnaires, il s’agit moins
aujourd’hui de problèmes techniques que du risque de prolifération de "
réseaux papier " visant à préempter des fréquences ;
- pour le partage entre systèmes non-géostationnaires, des problèmes
techniques demeurent pour assurer le partage d’une même bande entre plusieurs
systèmes. C’est à fait cette limitation qui a poussé la CMR-97 à ouvrir 10
fois plus de bandes aux systèmes non-géostationnaires que ne l’avait fait la
CMR-95 ;
- pour le partage entre systèmes non-géostationnaires et systèmes
géostationnaires, les études détaillées menées depuis la CMR 1997 confirment à
ce jour le bien fondé des décisions prises par l’UIT ;
- pour le partage de fréquences entre systèmes non géostationnaires et
systèmes de Terre, il existe des problèmes de coexistence entre les stations
terriennes des systèmes satellitaires et les stations des systèmes de Terre
dans les bandes partagées Ces problèmes se posent particulièrement lorsque la
densité de stations est élevée pour chacun des deux services - la bande des 18
GHz est la plus concernée par ces difficultés.
4.3. Aspects juridiques de l’activité des opérateurs de systèmes
spatiaux
Les procédures de l’UIT établissent une distinction claire
entre la coordination des systèmes à satellites entre eux et la coordination des
stations terriennes avec les services de Terre. De même, dans la pratique, il
existe une distinction analogue entre l’exploitant du système spatial (Iridium, Globalstar, SkyBridge, Teledesic,etc.) et l'opérateur de réseau au
niveau national (Tesam,etc.). En revanche, il n'existe pas en France de
distinction juridique explicite entre l'opérateur de station terrienne et
l’exploitant de satellite.
Par ailleurs, une démarche dans un seul pays au plan mondial est nécessaire
pour la partie proprement spatiale du système, puisque la coordination de cette
partie peut être réalisée par un seul pays auprès de tous les autres. En
revanche, il faut une autorisation dans chaque pays pour les stations terriennes
et pour l’exploitation commerciale du réseau.
5. SkyBridge, une
constellation de satellites non-géostationnaires pour le service fixe haut
débit
François BRUN - Vice President , Business Development, Alcatel SkyBridge
SkyBridge fait partie des
projets en cours de développement dans le domaine de la fourniture de services
multimédia haut débit par constellation de satellites "méga LEO". La
constellation devrait comprendre 80 satellites et être opérationnelle
commercialement à la fin 2001. Ce projet a été lancé en 1993 et réunit des
partenaires nord-américains (Com Dev, Spar, Loral), européens (Alcatel, CNES, SRIW) et japonais (Mitsubishi, Sharp et Toshiba).
5.1. Paramètres techniques stratégiques
Les choix stratégiques de
SkyBridge ont été les
suivants :
- toute l’intelligence du système se situe au niveau des stations
terrestres, les satellites n’étant que des relais de transmission
point-à-point entre les points terrestres ; il n’y a donc pas de commutation
embarquée, de même que dans Globalstar, et pas non plus de liens
intersatellites (interlinks) ;
- le temps de retour doit être relativement faible pour être acceptable en
haut débit multimédia (environ 30 ms), d’où le choix d’une constellation en
orbite basse (1469 km) ;
- le système doit être compatible avec les systèmes existants et être
capable de réutiliser des technologies déjà éprouvées ; un des objectifs était
également de le situer dans une bande de fréquence qui lui soit propre, d’où
le choix de la bande Ku (10-18 GHz).
5.2. Marchés visés
Le constat des promoteurs de SkyBridge est le suivant :
les progrès technologiques des transmissions terrestres devraient permettre
d’obtenir de hauts débit sur une partie des réseaux fixes actuels ; cependant,
il restera toujours une part du réseau limitée à des débits plus faibles, que ce
soit pour des raisons techniques ou financières, y compris dans des zones
relativement denses en consommateurs potentiels de services hauts débits. Ces
lacunes seront à même d’être comblées par des projets de type SkyBridge. C’est pourquoi SkyBridge ne vise pas les
sites professionnels denses (type "La Défense"), qui seront principalement
desservis par fibre optique, mais des zones à potentiel où la demande est moins
dense et se prête moins à une identification géographique aussi précise.
SkyBridge fournira sur
ces zones un service multimédia en boucle locale fixe, même si la couverture est
mondiale. Selon le modèle également développé par les autres opérateurs
satellites, SkyBridge
commercialisera son système à destination des opérateurs exclusivement, à charge
pour eux de créer et de commercialiser des services au consommateur final autour
de ce système.
5.3. Débits et tarifs
Pour les usagers résidentiel, qui devraient
représenter un tiers environ du chiffre d’affaires, le débit maximum ("crête")
offert par SkyBridge sera
de 20 Mb/s ; le débit moyen devrait pour sa part atteindre les 500 Kb/s ; pour
l’usage professionnel, les débits devraient être de trois à cinq fois supérieurs
à ces chiffres. La couverture sera, par définition, globale et la capacité à
l’échelle mondiale du système atteindra 215 Gb/s.
En termes tarifaires, SkyBridge prévoit une
commercialisation au kilobit et non à la minute, qui correspond mieux à la
transmission de données. Les prévisions de tarifs devraient permettre à SkyBridge de concurrencer les
systèmes terrestres ; en effet, il s’agit de 0,03 dollars par mégabit, ce qui
correspond à 0,04 dollars pour un appel téléphonique international de trois
minutes à 64 kb/s.
Les terminaux, devraient être d’une taille d’environ 50 cm, devraient être
commercialisés au prix de 700 dollars.
5.4. Questions à M. Brun
5.4.1. Quelle est la taille critique de la zone que doit couvrir chaque
passerelle pour que le système SkyBridge soit économiquement
viable ?
A l’inverse des systèmes géostationnaires qui diffusent de la
puissance partout même si elle n’est pas nécessaire, les constellations
permettent de limiter les zones couvertes aux seules zones souhaitées par
l’opérateur local et de concentrer les capacités à la demande.
Les satellites du système SkyBridge sont orientables,
permettant ainsi de concentrer plusieurs spots de 700 km de diamètre sur une
même zone. Il existera 18 spots pour chacun des 80 satellites de la
constellations. Une passerelle peut opérer sur une ou plusieurs zones selon
l’intensité du trafic.
5.4.2. Quel avenir peut-on prévoir pour les boucles locales "mixtes"
(voie descendante satellitaire, voie de retour par réseau terrestre bas débit)
?
Ces systèmes, qui ne sont pas vraiment interactifs, répondent plutôt à
une logique de diffusion avec l’envoi d’un même programme pour tous. En outre,
les boucles locales "mixtes" entraînent un retard à la transmission du à la
distance des géostationnaires par rapport au sol. SkyBridge étant un système
LEO, il offre des délais de transmission totalement compatibles avec les
services hautement interactifs, dans une logique de services point-à-point ou
point-multipoints. Aussi SkyBridge ne vise pas le même
marché.
5.4.3. Tous ces systèmes multimédias lancés par les industriels, et non
par les opérateurs, ne sont-ils pas principalement bénéfiques aux vendeurs de
matériel ?
Puisque tout le monde n'aura pas un accès haut débit avec les
systèmes actuels, les constellations de satellites multimédias se positionneront
en tant que compléments ou supports des réseaux terrestres. En outre, le
financement de ces systèmes est en partie assuré par les opérateurs. Si ces
derniers n'y voient pas leur intérêt, les projets ne vivront pas. On constate en
effet que, dans l'ensemble, les grands projets sont initiés par les industriels.
Certains industriels en profitent pour se positionner sur le secteur des
services et donc concurrencer les opérateurs. Le choix d'Alcatel dans SkyBridge est à l'inverse de
développer un système qui sera opéré par les opérateurs, Alcatel et les industriels partenaires de SkyBridge conservant leur
rôle de fournisseur de réseaux et de solutions techniques clef en main.
Au terme de cette demi-journée, on retiendra
en premier lieu que l’apparition des systèmes satellitaires a fait monter d'un
cran les difficultés techniques, financières ou juridiques par rapport aux
systèmes fixes ou mobiles terrestres. Certains aspects sont en outre
particuliers aux projets de constellations :
- le système doit être totalement opérationnel à l'ouverture, ce qui
représente des investissements financiers considérables avant la
commercialisation ;
- l'opérateur qui utilise la capacité spatiale fournie par l’exploitant du
système satellite doit pour espérer rentabiliser cet investissement obtenir
des licences dans chaque pays dans lequel il veut opérer, ce qui implique des
procédures longues et également coûteuses. Cette exigence motive le modèle de
commercialisation des constellations satellitaires, qui s’appuient sur un
partenaire local à même d’obtenir l’autorisation nécessaire ;
- le réglementeur doit faire face à de nombreuses sollicitations, qu'il
s'agisse du chantier permanent des CMR, des difficultés ponctuelles, tel
l'accord ad hoc qu'ont dû trouver Iridium et les radio-astronomes, ou bien
les questions nouvelles soulevées par la distinction entre exploitant de
système à satellites et opérateur de réseau, par les possibilités de
réorientation du trafic international et la réflexion sur le système des
quote-parts internationales que cela implique, etc.
Enfin, si la
question n’est aujourd’hui guère posée, il faudra également définir les
modalités d’application du droit de la consommation aux constellations de
satellites.
1 Les débats IDEE
Télécom sont un lieu informel de discussion sur des sujets d’intérêt général
du secteur des télécommunications et des technologies de l’information et de la
communications. Les comptes-rendus ne représentent donc pas la position des
organisateurs sur les sujets abordés et peuvent ne pas refléter exactement la
teneur des interventions et des débats. [RETOUR]
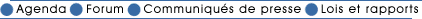
© Secrétariat d'Etat à l'industrie -
France
![]()
![]()